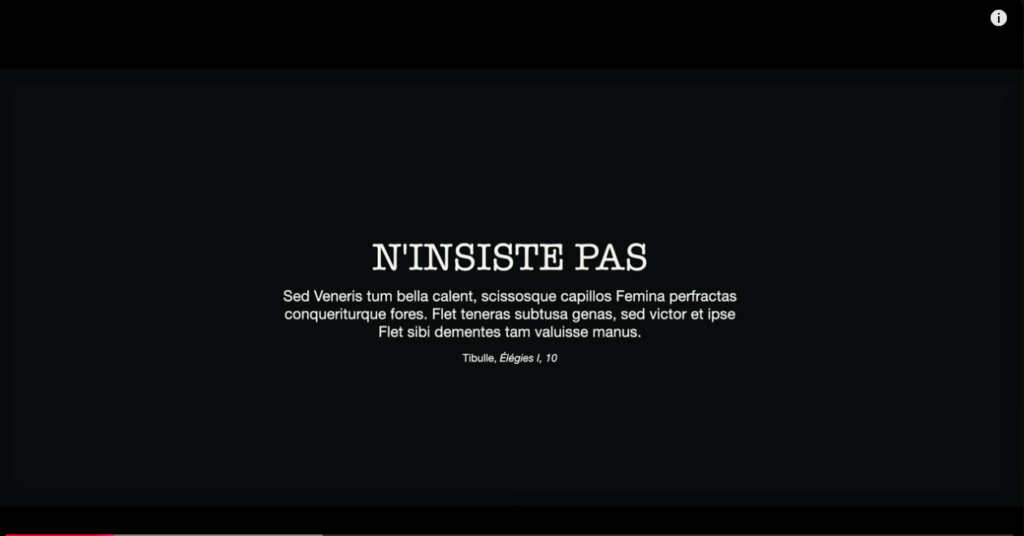Alors qu’ils se sont rencontrés en formation sur les bancs de l’IMEP à Namur, Thibaut Dervaux et Paschal Adans ont lancé leur entreprise Carte Son. Depuis le duo fait équipe dans le travail en plus d’être enseignants à l’HEAJ et à l’IMEP. Ils partagent les mêmes centres d’intérêts : la musique et la technologie, et surtout, les jeux vidéo. Avec leur parcours personnel et professionnel, leur histoire singulière s’inscrit dans la grande histoire de la Video Game Music, encore très peu documentée en Belgique francophone alors qu’elle gagne en légitimité dans les milieux académiques, même si le mouvement reste lent. Rencontre autour de la bande originale d’Asfalia® Fear : Panique au Manoir, jeu développé par Funtomata Studio (janvier 2025).
Propos recueillis par Manon Thomas
Manon Thomas : Quel a été votre parcours musical ? Votre premier contact avec la VGM? Vos influences ? et pourquoi la VGM ?
Thibaut Dervaux : « J’ai commencé la musique comme énormément de gens, enfant. J’avais huit ans et on m’a mis au solfège et quand on était à l’école, on avait souvent des cours à l’académie [ndlr : de Mouscron]. J’ai commencé par là en faisant du solfège et du piano qui était mon premier instrument. Le monde de la musique et plus particulièrement la part créatrice de la musique, m’est arrivé grâce au film qui est L’Etrange Noël de Mr Jack, que j’ai toujours adoré. Quand j’étais petit ce film m’a terrifié et en grandissant j’ai commencé à l’apprécier et, vu que je commençais à apprendre la musique, la question que je m’étais posée était : comment ça marche ? J’adore cette musique et je veux savoir pourquoi, comment on génère des émotions, etc. On ne peut pas prendre de cours de compositions quand on a dix ans donc j’ai d’abord fait le solfège et le piano durant mes années d’académie. A 18 ans, au moment du choix de mes études supérieures, je n’avais pas du tout pensé d’abord à la musique. Je pensais que cela allait rester un hobby, une passion. Et puis, je m’étais renseigné sur le Conservatoire royal de Liège en regardant la grille de cours. Quand j’ai vu que les cours n’étaient qu’en rapport avec la musique et que durant mes humanités je me désintéressais légèrement des matières générales et, sans études qui me bottaient… je m’étais dit : ‘faisons cela, faisons de la musique’ et je ne l’ai jamais regretté. Cela a plutôt commencé avant la musique de film. Danny Elfman est ma plus grande influence, carrément. C’est vraiment le compositeur de l’Etrange Noël de Mr Jack [ndlr : plus précisément Bienvenue à Halloween, (VF)], entre autres bien sûr, [M.T. : et des Simspon] qui est souvent associé à Tim Burton. Son style me plaît énormément et je pense qu’il m’a beaucoup plus influencé que je ne le pensais. Encore aujourd’hui, il y a encore des réflexes que j’ai qui viennent de mes longues heures d’écoute de Danny Elfman ». M.T. : « On le sent notamment dans les compositions pour Asfalia® Fear avec Overview 1 et Overview 2 ». T.D. : « Oui tout à fait, j’ai effectivement gardé cela en tête, c’était très conscient. Je joue aux jeux vidéo depuis que j’ai six ans, mais pour la musique de jeux vidéo, c’est arrivé plus tard étrangement. C’est la découverte de certains jeux indépendants dont l’univers musical m’a particulièrement parlé et qui m’ont fait me dire : ‘mais en fait, c’est cela que je veux faire’, comme le jeu Undertale [Toby Fox, 2015] dont je suis un énorme fan. Niveau musique, je me suis dit ‘ah ouais, trop bien’. Au début, je voulais faire de la musique de film et j’ai fini par me tourner vers celle des jeux vidéo ».
M.T. : Cela me fait penser à ce que disait Olivier Derivière, en 2018, que dans la musique de jeu vidéo, il y a plus de liberté que dans celle cinématographique parce qu’on connaît moins donc on laisse plus de liberté pour tout ce qui est créatif et langage musical ? Partages-tu cet avis ?
T.D. « Je suis complétement d’accord et en plus, on l’a senti avec Paschal du coup, on a un peu travaillé dans le film. Très souvent, alors que dans le jeu vidéo, on est plus vite intégré à l’équipe dès le départ, là où on a plus l’impression de remplir une commande dans le film en fait ».
M.T. : « C’est intéressant ce que tu dis, c’est totalement l’inverse de ce que déclarait Olivier Derivière justement, lors d’une conférence d’Audiokinetic à Los Angeles en 2018 : en caricaturant, l’idée était de dire que pour les développeurs, les compositeurs étaient des fournisseurs de fichiers wav ».
T.D. : « Ok, on a peut-être un peu de chance alors [rires] mais cela nous est moins arrivé. Il faut dire aussi qu’on a bossé que pour des petits studios indépendants donc il y a peut-être un côté un peu plus artisanal avec plus d’échanges que dans les gros studios comme Ubisoft avec lesquels il a bossé, ça c’est clair ».
M.T. : Et toi, Paschal, quel a été ton parcours ?
Paschal Adans : « Oula. Il va falloir remonter loin. Alors 1986, j’ai eu très tôt des contacts avec la musique. C’est très drôle parce que j’allais faire de la ‘rythmique et mouvement’ et du ‘pré-solfège’ dans les locaux de l’IMEP (Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie). Cette école de diplômés de pédagogie musicale et les étudiants proposaient des ateliers pour les enfants les week-ends et les mercredis. C’est comme ça que j’ai commencé et mon histoire est très liée à cette école parce qu’à quatre ans, j’étais déjà dans ces locaux. J’ai fait aussi l’académie que l’on appelait le Conservatoire de Jambes mais qui n’est pas un vrai conservatoire [ndlr : c’est un titre honorifique], où j’ai fait le solfège, de longues années de flûte traversière, piano, un peu d’écriture et encore les arts de la scène comme le théâtre et la déclamation… pareil où j’ai passé énormément de temps. J’ai fait aussi du chant choral pendant de longues années et j’ai fait vraiment beaucoup de choses durant ma jeunesse, pour revenir une première fois à l’IMEP en tant qu’étudiant en pédagogie musicale. Donc, j’ai fait mon AESI [ndlr : cursus, ancien régendat] en trois ans qui est une agrégation du cycle inférieur. En gros pour être professeur de premier cycle c’est-à-dire professeur de flûte à bec [rires]. Cela ferait enrager mes profs s’ils entendaient cela parce que c’est ce qui résonne le plus à l’oreille des gens malheureusement, mais on a tout appris sauf cela en fait ».
P.A. : « Je n’avais jamais enseigné au final et j’avais continué ma vie dans l’édition musicale et dans studios, mais j’avais mis la musique beaucoup de côté. Puis, j’ai repris, très fort sur le tard, à 35 ans, des études à l’IMEP de nouveau, en composition assistée par ordinateur, en informatique musicale, les mêmes que Thibaut [Dervaux]. Par contre, moi je n’ai fait que le bachelier et entamé le master sans le terminer, parce que justement, on a lancé Carte Son en même temps. On a commencé à très vite travailler, à faire des petits trucs et je me suis dit que je ne devais pas aller spécialement plus loin et que c’était plus important pour moi de travailler ».
M.T. : Et qu’est-ce qui t’a amené dans la musique du jeu vidéo ?
P.A. : « Parce que je suis un gros joueur aussi, je passe vraiment beaucoup de temps dans les jeux vidéo, plus qu’au cinéma ou quoique soit d’autre d’ailleurs. C’était vraiment un objectif. C’était de composer pour un jeu vidéo assez rapidement, sans trop savoir comment rentrer dedans, en travaillant ensemble Thibaut et moi. C’est vraiment parce qu’on a fait une rencontre un jour au KIKK Festival, un salon des arts numériques, en gros. C’est là qu’on a rencontré l’équipe de développement du jeu AgriLife (AgriLife Team, 2022) et en discutant, on s’est dit qu’on travaillerait bien ensemble et c’était notre premier contrat dans le jeu vidéo. On a commencé à travailler il y a cinq ans, parce que les temps de production d’un jeu sont longs, mais le jeu en lui-même est sorti il y a trois ans et on a travaillé dessus pendant un an ».
M.T. : Quels sont les défis que vous avez rencontrés en composant la BO d’Asfalia® Fear ?
P.A. : « Dans les défis, c’est de se comprendre avec les premiers morceaux sur le début [de la collaboration]. Je vais même remonter à Asfalia® Anger, le premier où on avait juste une seule track. Cela avait été très compliqué parce qu’on était organisé très différemment. On avait plusieurs attentes et chacun donnait son avis, la manière dont devait être la musique et nous avions notre idée aussi. Les avis n’étaient pas forcément convergents et finalement, quand on a été recontacté sur Asfalia® Fear […] pour la musique de la démo, elle contenait le mini-jeu du vaisseau spatial [Ghost Invaders écrite en chiptune en 16-bits avec les logiciels actuels]. Là, pareil, on nous donnait beaucoup de références de style, de choses qui n’était pas forcément …, la communication était compliquée. Quand Jean-Go[bert de Coster, chef développeur et producteur d’Asfalia®] a repris, presque tout seul, la partie artistique, concernant la musique, on a eu plus de liberté ».
M.T : La partie artistique, veux-tu dire la direction artistique ?
P.A. : « Oui, c’est-à-dire […] on était libre de proposer, il donnait ses avis. Là où, au début, cela ne fonctionnait qu’à beaucoup d’influences et parfois contradictoires, autant après, cela a été plus de lâcher prise : ‘Proposez et on verra avec cela’ et cela s’est très bien passé ».
T.D. : « Cela a vraiment été en s’améliorant, il y a eu beaucoup d’écoute par la suite, je dirais. Avec Jean-Go[bert], j’avais des réunions régulières pour parler de ce que j’avais fait, tout ça. De plus en plus, ça devenait une discussion plutôt qu’avoir un chef qui me disait ce qu’il voulait. Cela a été très agréable de bosser avec lui. Il disait par exemple : « bah, je trouve qu’à ce moment-là, je n’aurais pas mis cet instrument-là, qu’est-ce que tu en penses ? ». C’était plutôt ça. Soit, je lui disais qu’il avait raison et j’essayais autre chose, soit je défendais le truc en argumentant pour le convaincre. Il me disait ‘ maintenant que j’ai ton explication, c’est bien comme ça ‘».
M.T. : Avez-vous discuté d’une éventuelle « transmission de flambeau » entre l’opus Anger et l’opus Fear pour la continuité dans la composition, avec Lukas Piel ?
T.D. : « Si c’est le cas, c’est plus une décision de mon côté. On n’a pas eu de rendez-vous avec Lukas où il disait comment faire. J’ai essayé de rester dans des intentions et des choix instrumentaux qui restaient similaires avec le premier, même si on entend la patte des deux compositeurs […]. Jean-Gobert de Coster m’a demandé d’utiliser le thème, ce qui est parfaitement normal, de Charlie [qui est repris dans le générique de fin]. Vraiment, la mélodie utilisée pour le thème principal a été composé par Lukas et je me la suis réappropriée.
M.T : Pourquoi avoir introduit des jingles dans l’OST d’Asfalia® Fear alors qu’il n’y en avait pas dans Asfalia® Anger ?
T.D : « Ce n’est pas notre choix [rires]. Les jingles, c’est-à-dire les tout petits événements musicaux qu’il y a de temps en temps ont été ajoutés sur la fin. C’est Jean-Gobert qui a demandé d’avoir un plus par rapport à la musique de fond. C’est une des toutes dernières choses que j’ai dû faire et je trouvais l’idée pas trop mal. Il me semble que Demute Studio [responsable du sound design sur le jeu] se chargeait de ces jingles. Comme par exemple, dans le mini-jeu où il faut reconstruire la statue [funéraire] de Muffin, le chat. A la suite de cela, on s’était dit Paschal et moi que ce serait plus cohérent que ce soit ceux qui fassent la musique qui fassent les jingles aussi. Certains jingles de chez Demute Studio ont été gardés aussi par choix du producteur ».
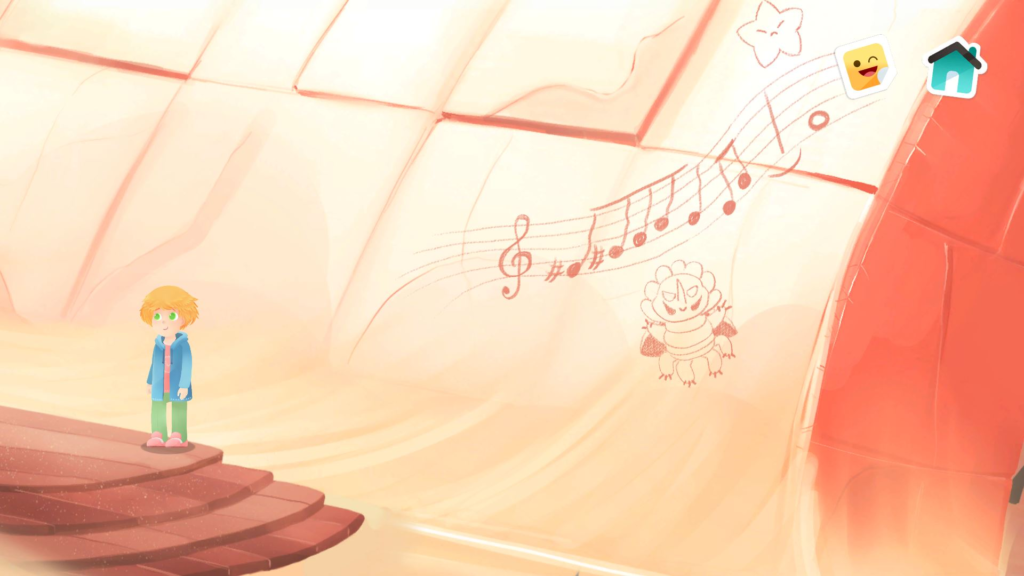
M.T. : Utilisez-vous le middleware Wwise ?
T.D. : « De moins en moins … quand on a l’occasion de pouvoir l’utiliser, Paschal et moi sommes ravis. Cela fonctionne extrêmement bien et c’est très confortable, etc. Malheureusement, on se rend assez vite compte, que parfois, assez souvent d’ailleurs les développeurs préfèrent soit faire leur intégration eux-mêmes, soit préfèrent l’évolution des moteurs [de jeu]. On pense à Unreal notamment, qui a un système qui s’appelle Metasounds. Il ne fait pas exactement la même chose, mais on peut arriver directement au même résultat qu’avec Wwise. Je commence à me rendre compte qu’il commence à perdre de son « intérêt » au fur-et-à-mesure des années, ce qui me désole d’ailleurs [rires] ».
M.T. : Comment vous cordonnez-vous avec le programmeur Thomas Finet et Jean-Gobert de Coster pour implémenter la musique dans le moteur de jeu pour Asfalia ? Cette procédure a-t-elle des influences sur votre manière de composer la musique ?
T.D. :« On n’a pas utilisé Wwise pour Asfalia. A nouveau, je n’ai pas tellement interagi avec Thomas à une exception. Cela a plutôt été l’inverse tel que je l’ai ressenti : on me demandait des compos pour tels et tels moments, etc. Jean-Go[bert] me dirigeait quelques fois artistiquement s’il fallait une musique un peu plus longue ou tel instrument lors de discussions. Ensuite, je fournissais les fichiers audios et je n’avais plus de « nouvelles », c’est eux qui se chargeaient d’implémenter cette matière première. Je n’ai pas eu le cas, pour Asfalia en tout cas où j’ai dû changer la musique à cause d’un problème d’implémentation. Il n’y a pas eu d’impacts techniques pour nous. Pour Ghost Invaders, il avait été question que ce soit une musique qui soit une musique évolutive dans le sens où, en fonction de la progression du jeu, les instruments se rajouteraient. Ils ont fait le choix que ce ne soit plus le cas, mais qu’on ait une version complète plutôt vite, etc., cela dépend des studios, mais moi, cela ne pose pas de souci. Je suis engagé pour fournir de la matière, après ils en font ce qu’ils veulent jusqu’à une certaine limite, bien sûr. Je ne suis pas vexé pour cela, c’est leur boulot ».
« Ce qui était, à mon sens nécessaire. Moi, je préfère bosser avec cela pour avoir un minimum d’inspiration visuelle même si je sais qu’il y a des compositeurs qui ne préfèrent pas. Jean-Go a fait une réunion préparatoire avant de commencer quoi que ce soit, pour nous donner une ou deux directives : on sait que c’est un jeu pour enfant, avec un côté ‘cartoon irréaliste’. Ce ne sera pas du réalisme à fond et cela doit rester enchanteur, onirique ».
Thibaut Dervaux
M.T. : Beck Allen déclarait dans The Beep Book de Karen Collins et Chris Greening (2016), que: « vous ne pouvez pas aborder ce logiciel de manière linéaire, et vous devez l’aborder dans un état d’esprit interactif » (traduit de l’anglais), déjà en 1994 alors qu’elle travaillait chez Microsoft – début de la microinformatique. Elle parlait d’un programme informatique qui générait des progressions harmoniques. Que pensez-vous de cette posture aujourd’hui ? Comment infuse-t-elle dans votre processus créatif ?
T.D. : « L’interactivité est le point qui fait que la musique de jeu vidéo est de la musique de jeu vidéo, c’est que l’on peut, sans y être obligé, faire ce qu’on appelle la musique interactive, adaptative, interactive, etc., les gens utilisent des termes différents pour dire la même chose. La grande différence, c’est que ce n’est pas linéaire. Dans un film, on va d’un point A à un point B. Le spectateur va regarder le truc sans aucune incidence. Il prend le film avec ce qu’il se passe en synchro et c’est comme cela. Nous, dans le jeu vidéo, on peut très bien avoir un joueur qui va finir le jeu en douze minutes, un autre qui va prendre six heures. On ne pas prévoir qu’elles sont les capacités ou même les envies du joueur, et on doit penser à toutes ces personnes-là, en fait. On doit se dire, par exemple, typiquement pour Infinite Forest dans Asfalia, il a fallu se poser la question en se demandant : combien de temps vont mettre, en moyenne, les joueurs pour savoir quelle durée doit avoir notre musique, pour être certain qu’un maximum d’entre eux entende cette fameuse musique qui est adaptative et qui évolue pendant qu’on traverse la forêt ».
M.T. : Il y a l’auteur Chance Thomas qui conceptualise cela par ‘une mise à l’échelle du temps’, c’est-à-dire qu’il y a un temps effectif, comme tu le dis, on ne sait pas combien de temps ça va prendre à la joueuse de réussir l’action et c’est aussi pour cela que la musique est implémentée en loop [en boucle] ». P.A. : « et encore pas toujours. Pour infinite Forest, ce n’est pas une vraie loop ». [Ndlr : il s’agit d’un enchaînement de trois versions avec un leitmotiv musical commun donnant une illusion de loop alors qu’il s’agit plus d’une progression narrative par la musique].
M.T. : Je me permets de rebondir sur les autres compositions qui sont de nature d’underscoring ou d’ambiance, où la musique est implémentée en loop et la musique suit une logique narrative linéaire. Je m’avance en disant qu’Asfalia®Fear est tout de même un ‘jeu-conte’ qui a d’abord été pensé comme une histoire, comme un ‘film’. Il y a moins cette idée d’interactivité même si bien sûr, elle est présente. Dès lors, quelle a été votre posture créatrice pour composer pour le nouvel Asfalia ?
T.D. : « Oui, il y a eu beaucoup plus de musiques non-interactives que de musiques interactives dans Asfalia. C’est presque un film interactif Asfalia, d’une certaine manière. C’est une fable qu’on suit presque. A part, la forêt infinie, il n’y a pas tellement de musiques interactives. Dans ce cas-là, et je le dis souvent à mes étudiants [de] l’IMEP, justement. Pour leur apprendre comment faire de la musique interactive. Il y a un ‘danger’ quand l’on commence à travailler dans le jeu vidéo et que l’on découvre la musique interactive, parce que c’est génial [rires], c’est que l’on veut en mettre partout et tout le temps alors que ce n’est pas toujours nécessaire [ndlr : conseil qu’il avait lui-même reçu lors de son arrivée pour son stage chez Demute Studio]. C’est le cas d’Asfalia. Une musique non-interactive n’a pas forcément moins de valeur qu’une musique interactive, c’est juste que l’objectif n’est pas le même du tout. Il n’y a pas de jugement à faire là-dessous. Asfalia a été pensé comme des tableaux en parlant des niveaux du jeu. On peut vraiment parler de scène avec une identité musicale ».

M.T. : Avez-vous eu accès au contenu du jeu en primeur ? Comment avez-vous fait pour travailler sur le projet et trouver l’inspiration ?
P.A. : « À la base, on a eu que des captures d’écran des zones en construction et des concept art en fait, des zones, puisqu’ici les musiques étaient essentiellement [pensées] par zones. On n’avait pas de synopsis, car on a été tenu dans le secret pour cela, sauf par des cas bien précis pour l’Ombre par exemple ou pour la forêt de nouveau, on savait quel allait être le déroulement. Jean-Gobert voulait une ambiance qui évolue justement, qui devienne de plus en plus sombre et de plus en plus chaotique. C’étaient des informations que l’on a eues en amont, et c’est pour cela qu’on l’a composée de cette manière-là ».
T.D. : « Ce qui était, à mon sens nécessaire. Moi, je préfère bosser avec cela pour avoir un minimum d’inspiration visuelle même si je sais qu’il y a des compositeurs qui ne préfèrent pas. Jean-Go a fait une réunion préparatoire avant de commencer quoi que ce soit, pour nous donner une ou deux directives : on sait que c’est un jeu pour enfant, avec un côté ‘cartoon irréaliste’. Ce ne sera pas du réalisme à fond et cela doit rester enchanteur, onirique. C’est lors de cette réunion où il a dit qu’on pouvait s’inspirer du travail de Danny Elfman. Bon c’est là, où j’ai levé les bras en l’air évidemment. Mise à part ces infos-là, on a eu globalement carte blanche et on a demandé les captures d’écran ».
M.T. : Pour l’instrumentation non-occidentale que tu as utilisée, le duduk pour le thème Shadow et pour Frozen Garden, notamment, as-tu dû faire beaucoup de recherches ? Quel élément te décide-t-il à choisir un instrument plutôt qu’un autre ?
T.D. : « Alors oui, c’est un instrument que j’aime beaucoup et je l’ai associé au thème de l’Ombre en général. Je n’ai pas fait beaucoup de recherches parce que c’est un instrument que l’on appelle plus ‘cliché’ [rires]. Il est très utilisé dans les jeux vidéo pour les niveaux désertiques par exemple. Il y a un côté très mystérieux. Cela fait penser à un serpent qui se lèvent comme ça, avec les fakirs qui jouent, il y a un côté qu’on associe au mystère de manière générale. Au moment où j’ai dû composer le thème de Shadow, il a fallu réfléchir aux instruments, aux harmonies. Souvent je démarre avec une mélodie et une harmonie qui me viennent un peu dans le même temps. J’ai besoin de m’imprégner pour nourrir mon imaginaire et mon inconscient. L’idée vient ‘me tomber dessus’ et je me dis ‘ah tiens, ça, c’est pas mal’. Je fais souvent un premier jet de la mélodie et de l’harmonie, ensuite je l’intellectualise et je modifie. C’est très instinctif au départ et puis j’intellectualise. Normalement, l’instrumentation vient après mais ici, c’était plutôt une évidence pour le duduk puisqu’on ne sait pas qui est l’Ombre, c’est un mystère qui est caché ».
M.T. : On arrive à la fin de cette discussion, avez-vous quelque chose à rajouter ?
T.D. : « Non, cela couvrait pas mal de choses, c’est cool ».